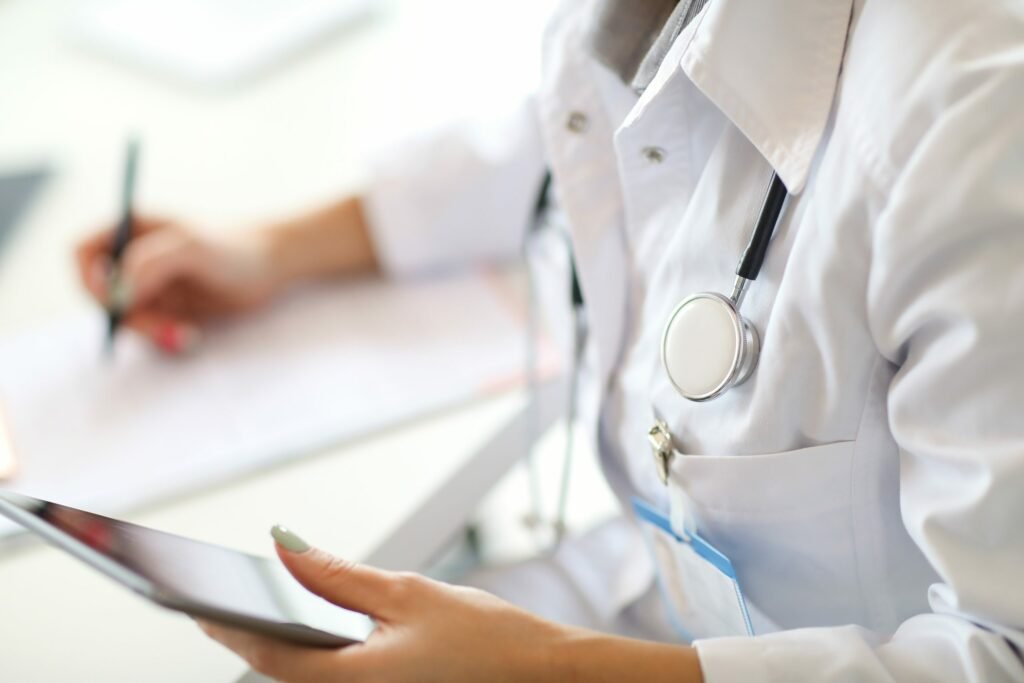Une perspective à débattre.
Le 24 mars 2025, l’Anses a dévoilé les résultats de ses 2 comités d’experts spécialisés (CES) sur la consommation humaine en isoflavones, dont le soja est le plus grand vecteur dans la population humaine. Ces expertises interviennent suite à une saisine de la Direction générale de l’alimentation (DGAL) et de la Direction générale de la santé (DGS), intitulée « évaluation du risque sanitaire de la consommation d’aliments contenant des isoflavones en lien avec le risque de perturbation endocrinienne ». Il s’agit de répondre à 4 points :
- Quelle est la valeur toxicologique de référence (VTR) à long terme pour l’ingestion d’isoflavones, en tenant compte des différentes populations ?
- Quels aliments courants riches en isoflavones et quelles quantités maximales peuvent être consommées pour ne pas dépasser la VTR, selon chaque catégorie de population ?
- Y a-t-il des liens entre l’exposition des nourrissons aux isoflavones par les préparations à base de soja ou l’allaitement et leur santé à différents âges ?
- Quelles sont les recommandations pour la fréquence et les portions d’aliments à base de soja dans les repas collectifs pour différents groupes : enfants en scolaire, enfants en crèche, adultes en entreprise et personnes âgées en EHPAD ?
A la suite d’une analyse toxicologique et l’extrapolation de données obtenues sur des rats, le groupe de travail estime que, parmi les consommateurs et consommatrices de soja, 76% des enfants de 3 à 5 ans, 53 % des filles de 11 à 17 ans et 47 % des hommes de 18 ans et des femmes de 18 à 50 ans, dépassent la VTR. L’agence aboutit à la recommandation d’éviter le soja en restauration collective. Elle encourage également les industriels et les producteurs de prendre des mesures pour maîtriser les teneurs en isoflavones du soja.
Cet avis peut surprendre, notamment au regard de la littérature scientifique et des recommandations que l’on peut trouver au niveau international. Vous trouverez plus d’informations sur ces aspects dans notre position sur la consommation de soja.
D’ailleurs, chose suffisamment rare pour être soulignée, il est signalé dans la synthèse que deux experts du CES ont exprimé une opinion divergente et n’ont pas validé les documents de synthèse en argumentant que :
- Certains éléments concernant la VTR n’étaient pas encore connus et validés. Ils leur semblent impossible de se positionner sans avoir tous les éléments.
- Les recommandations fixent des taux très inférieurs aux quantités qui sont actuellement consommées.
- Les recommandations sont fondées sur des extrapolations à partir d’études sur des animaux non humains et ne sont pas retrouvées dans les études épidémiologiques humaines.
- Au contraire, certaines études épidémiologiques suggèrent des avantages à la consommation de soja, notamment sur la réduction des risques de décès par cancer et de maladies cardiovasculaires.
- L’évaluation devrait également comprendre les bénéfices de la consommation de soja et avoir une vision plus globale.
- Les données épidémiologiques humaines devraient davantage être prises en compte.
Nous ne pouvons qu’être d’accord avec eux !
Nous soulignons également que la France se trouve dans une position isolée au niveau international et que la position adoptée par l’Anses va à l’encontre des objectifs de santé publique et de transition vers une alimentation davantage végétale, en se fondant sur des arguments jugés peu convaincants.
Nous avons interpellé l’Anses à ces sujets, sans obtenir de réponse.
Pour aller un peu plus loin, détaillons maintenant la méthodologie de l’Anses qui a donc publié deux rapports d’expertise collective : VTR long terme par voie orale pour les isoflavones et un avis relatif à une demande d’évaluation du risque sanitaire de la consommation d’aliments contenant des isoflavones
1. VTR long terme par voie orale pour les isoflavones
Pour ce rapport, le CES indique s’être appuyé sur des synthèses de la littérature : Afssa, 2005, Efsa 2015, Anses 2016, VKM 2017, NCM 2020 et SCCS 2022 et sur une recherche bibliographique de 2021 à 2024.
Comme nous l’avions déjà souligné dans notre position, il est étonnant de voir mêler des études portant à la fois sur la consommation d’aliments à base de soja et sur la prise de complément alimentaire à base d’isoflavones. De même, les études sur les animaux non humains apparaissent difficilement extrapolables aux humains.
En ce qui concerne les rapports de synthèse, plusieurs éléments nous interpellent :
- Efsa 2015 : Il s’agit d’un document de synthèse de l’autorité européenne de sécurité des aliments. Cette synthèse ne concerne que les compléments alimentaires (Risk assessment for peri- and post-menopausal women taking food supplements containing isolated isoflavones)
- VKM 2017 : Il s’agit du Comité scientifique norvégien pour l’alimentation et l’environnement. Cette synthèse semble concerner également les compléments alimentaires.
On note cependant les éléments suivants :
« L’Autorité norvégienne de sécurité alimentaire (NFSA) a demandé au Comité scientifique norvégien pour la sécurité alimentaire (VKM) d’évaluer la sécurité des isoflavones de soja dans les compléments alimentaires aux doses suivantes : 40 et 80 mg/jour. »
« En raison des différences de pharmacocinétique entre l’homme et les espèces de rongeurs telles que décrites et de l’abondance des études humaines disponibles sur les isoflavones, les données de toxicité provenant d’animaux de laboratoire n’ont pas été incluses dans cette évaluation des risques, à l’exception des données de génotoxicité in vivo. »
« Il est très peu probable que les régimes alimentaires normaux à base de plantes contiennent des isoflavones en quantités suffisantes pour induire des effets indésirables graves, étant donné qu’ils font partie de l’alimentation humaine depuis des centaines d’années et qu’il n’existe pas de données historiques sur des effets toxiques évidents. »
- NCM 2020 : Le conseil nordique des ministres est une organisation intergouvernementale créée par les pays nordiques regroupant des ministres de chaque pays sur un sujet précis.
On peut notamment lire dans ce document :
« Aucun effet critique des isoflavones sur les enfants ou les femmes enceintes (enfants à naître) n’a été identifié parmi les quatre critères d’évaluation inclus : moment de la puberté, cancer du sein, hypospadias et fonction thyroïdienne dans les études humaines. »
- SCCS 2022 : Le Comité scientifique pour la sécurité des consommateurs se positionne sur la teneur de produits cosmétiques en génistéine et daidzéine…
Pourtant, au regard de ces éléments, le CES indique la VTR long terme par la voie orale est fondé sur l’augmentation de l’incidence de l’hyperplasie alvéolaire et canalaire de la glande mammaire chez le rat mâle. La VTR long terme par la voie orale chez la femme enceinte, en âge de procréer et les enfants prépubères est donc fondée sur :
- une diminution du poids relatif des épididymes des rats mâles exposés in utero et après la naissance,
- une diminution de la taille des portées issues de l’accouplement des mâles de la génération F1 et de femelles non exposées.
Notons que les recommandations des pays nordiques, qui reposent notamment sur les synthèses VKM 2017 et NCM 2020, indiquent les préparations infantiles (PI) à base de soja comme une possibilité et la consommation de soja comme saine (également dès la diversification, chez les enfants ainsi que les femmes enceintes et allaitantes).
2. Avis relatif à une demande d’évaluation du risque sanitaire de la consommation d’aliments contenant des isoflavones
Le CES évalue l’impact de prise de préparation infantiles (PI) à base de soja sur la santé et le développement de l’enfant.
2.1. Croissance osseuse et soja au regard de la consommation de PI à base de soja
(Storm et al 2001, Giampietro et al. 2004, Sobik et al. 2020, Chen et al. 2023).
- Aucune association entre consommation d’une PI à base de soja et la santé osseuse de l’enfant de plus de 2 ans, ni la taille à l’âge adulte, comparée à une PI à base de protéine de lait de vache (poids faible).
2.2. Santé cardioneurovasculaire
(Pivik et al. 2013, Pivik et al. 2015, Portman et al. 2016)
- Davantage de risque de maladie de Kawasaki chez les enfants d’origine asiatique (preuve faible)
2.3. Effet endocriniens
(Strom et al. 2001, Giampietro et al. 2004, Gilchrist et al. 2010, Adgent et al. 2011, Adgent et al. 2012, Barthold et al. 2012, Andrès et al. 2015, Adgent et al. 2018, Sinai et al. 2019, Chin et al. 2021)
- Davantage de risque d’avoir des règles précoces (avant 12 ans) si la consommation de PI à base de soja est débutée avant 4 mois (preuve faible).
Cette conclusion peut surprendre, d’autant que cela concerne une seule étude dont le groupe « consommation précoce de soja » ne comportait que 54 filles sur les 2920 sujets inclus. De plus, on note que l’âge médian ne diffère pas entre les groupes et qu’il est indiqué que l’effet peut être surestimé en raison de la censure informative. D’autres études ne montrent pas de différence concernant l’âge de la puberté et la consommation de PI à base de soja.
- Pas de différence de développement de certains marqueurs sexuels par rapport à une PI à base de protéine de lait de vache (poids faible)
2.4 Développement cognitifs
(Bellando et al. 2020, Sobik et a. 2020, Ha et al. 2021, Alatorre-Cruz et al. 2023)
- Consommation de PI à base de soja comparée à une PI à base de protéines de lait de vache est associé à une altération de certains aspects du développement cognitif (langage, maturité cérébrale et hyperactivité chez les garçons) et à une amélioration du score de reconnaissance différée chez les garçons (poids faible).
Alors même que les auteurs et autrices de l’étude indiquent que leurs résultats sont à prendre avec précaution, le CES choisit de s’appuyer sur ces résultats pour ses recommandations. Qu’en est-il de la pertinence clinique de ces différences ?
De plus, concernant l’hyperactivité, ce n’est pas le soja qui est pointé, mais le manganèse, avec un intervalle de confiance très proche de 1 : [1.004-1.661].
Nous pouvons également lire dans l’étude de Bellando, 2020 :
« Les scores relatifs aux performances intellectuelles, et de langage (intelligence verbale, communication expressive, et compréhension auditive) à 3, 4 et 5 ans, étaient comparables chez les enfants ayant consommé une préparation infantile à base de protéines de soja ou à base de protéines de lait de vache. Ces enfants nourris avec des préparations infantiles montraient des scores plus faibles que les enfants ayant été allaités »
2.5 Statut nutritionnel et métabolique
(Cruz et al. 1994, Han et al. 2011)
- Aucune association entre la consommation d’une PI à base de soja comparé à une PI à base de protéine de lait de vache et les statuts nutritionnels et métabolique (poids faible)
Suite à cette revue de la littérature, le CES VSR a réalisé une synthèse des effets observés chez les humains et les animaux non humains, en s’appuyant sur des synthèses d’organismes reconnus : Efsa, VKM, NCM et SCCS publiés entre 2015 et 2022, ainsi qu’une recherche bibliographique de 2021 à 2024. Ainsi, on constate que la VTR long terme pour la génistéine a été élaborée à partir d’études sur les rats pour la population générale et pour les femmes enceintes (p30). Le CES précise que ces deux VTR ont été élaborées en suivant une méthode validée pour les agents chimiques auxquels l’exposition est dangereuse, comme les pesticides. Le CES rappelle que les éventuels effets bénéfiques des isoflavones ne sont pas considérés.
Ensuite, l’étude des aliments consommés en France a permis d’estimer le pourcentage de personnes susceptibles de dépasser ces taux. C’est-à-dire 76% des enfants de 3 à 5 ans, 53 % des filles de 11 à 17 ans et 47 % des hommes de 18 ans et des femmes de 18 à 50 ans.
Le CES reconnaît que le développement de certains marqueurs sexuels ne diffère pas entre les PI à base de soja et celles à base de protéines de lait de vache, et qu’il n’existe pas de preuves d’un impact cliniquement pertinent à cet égard. Cependant, le même CES mentionne un risque dans ses conclusions. Cela soulève des questions sur la cohérence des recommandations fournies.
C’est au regard de ces éléments que le CES préconise de ne pas servir de plats contenant du soja en restauration collective.
Le soja, bien qu’il ne soit pas un aliment indispensable, présente des caractéristiques nutritionnelles et environnementales intéressantes. Il est regrettable de constater que l’ANSES adopte une position défavorable à sa consommation dans le cadre d’une évaluation qui est généralement réservée aux pesticides. De plus, il existe de nombreuses études épidémiologiques qui, tout en étant rassurantes, suggèrent également des bénéfices potentiels liés à sa consommation. C’est en tout cas la position adoptée par plusieurs organismes de santé à l’international. Il est important de les examiner aussi afin d’obtenir une compréhension complète de l’impact du soja sur la santé.
Que ce soit le soja ou notre santé, ils méritent mieux !
Dr Sébastien Demange
Médecin spécialiste en médecine générale
Master de santé publique